Comment mieux gérer ces milieux fragiles et pourtant protecteurs, notamment face au changement climatique ? Une question à laquelle répond l’ouvrage paru en octobre 2025 aux éditions Quae, librement accessible en ligne. Dans le texte ci-dessous, ses coordinateurs scientifiques expliquent pourquoi et comment protéger ces bijoux méconnus de biodiversité.
Parlez de rivières, de fleuves, de ruisseaux… les images qui viennent à l’esprit sont presque systématiquement des images avec de l’eau, ou au contraire de chenaux à sec.
Pourtant, les cours d’eau ne sont pas que des tuyaux qui transportent de l’eau, ce sont aussi des forêts. En conditions naturelles, une végétation particulière pousse en effet sur leurs berges, à laquelle on donne plusieurs noms : ripisylve, forêt alluviale, boisement riverain, cordon riparien, forêt-galerie, etc.
Ces forêts méritent d’être mieux connues : elles représentent en effet un atout important pour la gestion durable des territoires dans le contexte des changements globaux (changement climatique, déclin de la biodiversité, etc.) que nous vivons.
Une forêt pas comme les autres
Quel que soit le nom que l’on donne à ces forêts, cette végétation est particulière, car elle est connectée au cours d’eau.
Lors des inondations par exemple, de l’eau passe du chenal vers la forêt, et avec elle aussi des sédiments, des graines, des nutriments, etc. Il en résulte des conditions écologiques différentes du paysage alentour. Par exemple, la végétation a accès à davantage d’eau et pousse plus vite.
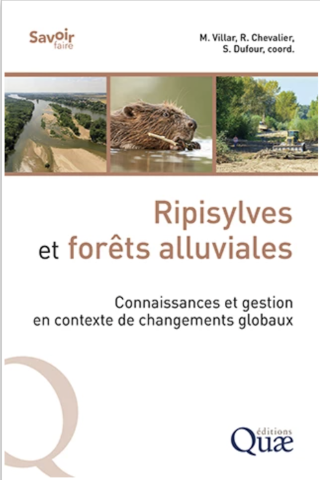
Ripisylves et forêts alluviales, ouvrage coordonné par Marc Villar, Richard Chevalier et Simon Dufour. Éditions Quae (2025)
Mais elle doit également s’adapter à la présence de l’eau. Celle-ci peut engorger le substrat pendant plusieurs semaines, et les crues qui peuvent éroder les sédiments – et, par la même occasion, arracher le substrat sur lequel elle pousse.
Les forêts de bord de cours d’eau sont donc des écosystèmes uniques : ni complètement aquatiques ni complètement terrestres, composés d’une végétation particulière avec des espèces adaptées comme les saules, les aulnes, les peupliers, etc.

Un saule pleureur sur l’Ognon en Franche-Comté. Arnaud 25/WikiCommons, CC BY-SA
Non seulement elles abritent des espèces spécifiques, ce qui augmente la biodiversité à l’échelle régionale, mais elles en accueillent aussi une grande quantité sur des surfaces relativement petites. En effet, les conditions sont localement très variables (de très humides à très sèches), ce qui crée des mosaïques d’habitats.
Des observations réalisées sur une trentaine de sites couvrant seulement 7,2km2 le long de l’Adour (dans le sud-ouest de la France, ndlr) recensent ainsi près de 1 500 espèces végétales pour ce seul cours d’eau. Cela représente environ 15 % de la flore vasculaire – un groupe de plantes qui recoupe les angiospermes (ou, plantes à fleurs), les gymnospermes, les monilophytes et les lycophytes – de France métropolitaine, alors que la surface couverte ne représente que 0,0013 % du territoire français.
Le cours d’eau influence donc la végétation des rives, mais les forêts des bords de cours d’eau influencent aussi grandement le fonctionnement de ce dernier en retour.
De multiples services rendus à la société
Les forêts alluviales et les ripisylves ne sont pas seulement des viviers de biodiversité : elles fournissent également des services écosystémiques précieux pour nos sociétés.
Elles participent ainsi aux stratégies d’atténuation face au changement climatique, en stockant du carbone en grande quantité. Du fait des conditions humides, leur croissance et leur biomasse sont parfois aussi importantes que celles des forêts tropicales. En été, elles limitent la hausse de la température de l’eau des petites rivières jusqu’à 5 °C, ce qui est précieux pour la faune aquatique. En outre, elles piègent des sédiments, des nutriments et des substances qui dégradent la qualité physico-chimique des cours d’eau.
Dans certaines conditions, elles contribuent par ailleurs à ralentir la propagation et à réduire l’ampleur des ondes de crues entre l’amont et l’aval des bassins versants.
Au-delà de leur biodiversité végétale propre, elles fournissent des ressources alimentaires, des habitats et des corridors de déplacement à de nombreuses espèces aquatiques, semi-aquatiques et terrestres, telles que les poissons, le castor, les chauves-souris, etc. Elles participent, enfin, à former un paysage agréable, apprécié des différents usagers des cours d’eau (promeneurs, pêcheurs, cyclistes, etc.).
Ces forêts ne sont toutefois pas miraculeuses. La qualité de l’eau dépend également d’autres éléments, comme les pressions sur la biodiversité qui s’exercent dans le bassin versant.
Si la présence de ces forêts est un réel atout, elle n’est pas un blanc-seing qui permettrait de faire l’impasse sur les effets de certaines activités humaines, comme l’artificialisation des sols, l’agriculture intensive, les rejets de stations d’épuration ou le relargage de plastiques, sur la qualité des cours d’eau. Historiquement, les cours d’eau et leurs abords ont en effet souvent concentré ces impacts délétères.

Les ripisylves sont appréciées de nombreuses espèces, comme le castor, mais également des promeneurs. Nasser Halaweh/Wikimédia, CC BY-SA
Un joyau sous pression
À l’échelle de l’Europe, on estime que seuls 30 % des zones riveraines de cours d’eau sont encore boisées, alors qu’elles pourraient l’être à plus de 95 %.
Ce chiffre cache toutefois une très grande variabilité entre pays : ce taux peut atteindre une moyenne de 50 % en Scandinavie et descendre à 10 % en Angleterre et en Irlande. Dans certaines régions de moyenne montagne ou de déprise rurale, les superficies augmentent, mais à l’échelle continentale, ces milieux continuent de régresser. Entre 2012 et 2018, 9 000 hectares ont disparu chaque année, en Europe. Près de 50 % de ces étendues ont été réaffectées en surfaces bâties, 25 % en parcelles cultivées et 25 % en praires.

Une ripisylve sous pression (route, autoroute, voie ferrée, gravière, usine, carrière, habitations, etc.), la vallée l’Arc au niveau de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie). Marc Villar, Fourni par l'auteur
Lorsqu’ils existent, ces boisements subissent en outre d’autres pressions : perte de caractère humide du fait des prélèvements en eau et du changement climatique, présence d’espèces exotiques envahissantes, propagation de maladies touchant les arbres comme le phytophthora ou la chalarose, mauvaises pratiques d’entretien, etc.
Résultat : ils sont parmi les habitats semi-naturels européens dans le plus mauvais état de conservation, puisque seulement 5 % sont considérés comme dans un état favorable. Or, il a été démontré que le faible boisement des berges et leur dégradation limitent drastiquement leur qualité écologique et leur capacité à rendre les services écosystémiques mentionnés plus haut.
Dépasser la volonté de « faire propre »
Reconnaître toute la valeur des forêts des bords de cours d’eau doit amener à définir comme objectifs prioritaires des politiques environnementales trois grandes stratégies :
- conserver l’existant,
- restaurer ce qui est dégradé,
- et améliorer les pratiques quotidiennes de gestion.
Mais il ne suffit pas d’énoncer ces grands principes. Leur mise en œuvre concrète et à large échelle peut s’avérer complexe du fait de la coexistence d’enjeux multiples, qui relèvent de plusieurs échelles spatiales et impliquent de nombreux acteurs : inondations, biodiversité, quantité et qualité de l’eau, usages divers, espèces envahissantes, obstacles à l’écoulement, etc.

Grande plaine inondable boisée par une large forêt alluviale dans le bassin de l’Èbre en Espagne. Patricia Rodríguez-González, CC BY-NC-SA
Heureusement, des solutions existent : plan pluriannuel de gestion, diagnostic et gestion sectorisés, techniques de génie végétal, méthodes et indicateurs de suivi adaptés, outils de conception des actions de restauration ou des mesures de conservation, etc.
Beaucoup reste à faire : la gestion des forêts alluviales et des ripisylves s’appuie parfois plus sur l’habitude ou sur la volonté de « faire propre » que sur l’évaluation factuelle des enjeux. Elle doit aussi être considérée comme suffisamment prioritaire pour que des moyens humains et financiers suffisants lui soient consacrés et que les bonnes pratiques soient plus largement partagées.
Mais c’est une logique payante pour relever les enjeux environnementaux contemporains, notamment en matière de moyens financiers et humains, car ces forêts apportent de nombreux bénéfices alors même qu’elles occupent une superficie réduite et qu’elles ont été très dégradées. À l’interface entre l’eau et la terre, les ripisylves et les forêts alluviales souffrent d’une faible visibilité, aussi bien dans les politiques environnementales que dans le grand public, ce qui constitue un frein à leur prise en compte. Il s’agit donc de travailler à faire (re)connaître leurs valeurs, leurs fonctions et leurs spécificités.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.





